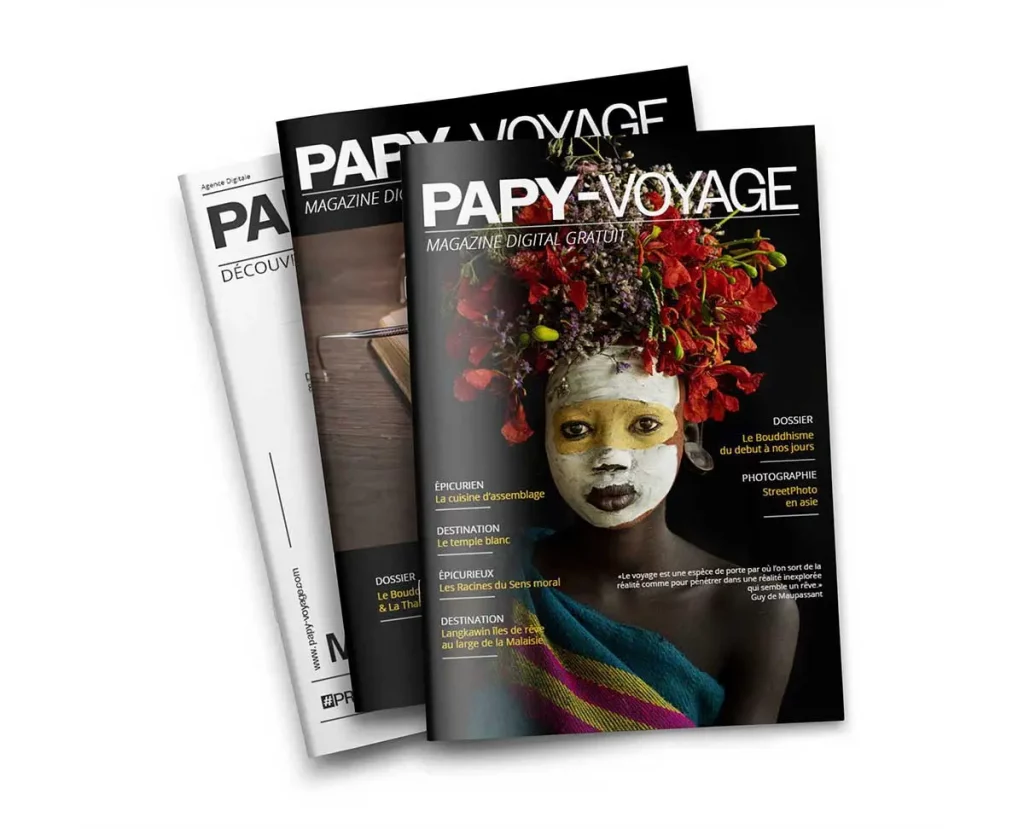La ville et la forteresse de Bélogradtchik. A découvrir en Bulgarie dans les Balkans.
La Bulgarie
Un pays à la nature préservée
Les montagnes bulgares abritent une très grande bio-diversité, tout aussi bien animale que végétale dont des espèces endémiques. Les grandes montagnes sont l’habitat de l’ours, du loup, du chacal et du renard, des cervidés, des grands sangliers. En comparaison avec la France, l’ours est (tout comme le loup), par exemple, véritablement présent, avec une bonne population de l’espèce. Les dernières années l’on voit la réapparition du lynx (bien présent dans les forêts à la fin du XIX siècle). Plusieurs réserves de chasse de renommée internationale sont établies en Bulgarie, sans oublier la réserve, ou plutôt la maison de repos, pour les Ours dansants dans les Rhodopes, près de la ville de Bélitza
Sommaire

Les montagnes
Les montagnes occupent une partie importante du territoire de la Bulgarie. D’origines géologiques variées, elles donnent lieu à des paysages forts différents dont le décor change rapidement, pour le plaisir des voyageurs.
Au nord et au centre
S’élève la longue chaîne de Stara Planina (le Balkan), séparée de la plaine du Danube par le Pré-Balkan (ou encore l’Anti-Balkan). Coupant la Bulgarie en deux sur toute la longueur, elle a donné le nom de la péninsule des Balkans.
Dans les sud-ouest et le sud
Se dressent les imposants massifs de Rila, Pirin et les Rhodopes, dont le mont Moussala en Rila atteint presque les 3 000 mètres (2 927). Au sud-est la partie nord de Strandja fusionne avec le littoral de la mer Noire. A l’ouest un enchaînement de montagnes trace la frontière de la Bulgarie, le long de la rivière de Strouma. N’oublions pas Vitocha, qui trône au-dessus de Sofia, la capitale de la Bulgarie, avec son mont Tcherni Vrah à 2 196 m.
Réserves naturelles
La grande majorité des montagnes bulgares sont placées sous le statut de parc naturel ou de réserve naturelle (le parc de Rila et de Strandja sont parmi les plus anciens en Europe).

Les sources thermales
La grande variété de sources minérales a contribué à l’établissement (et souvent depuis l’Antiquité) de stations thermales en montagne. Les plus connues sont celles de Vélingrad, Narétchen et Kyustendil. Les montagnes bulgares abritent la plupart des monastères orthodoxes et tous les villages de caractère.
Histoire consensée
Les Thrace
Ils sont l’une des plus anciennes civilisations en Europe. Le cœur de leur territoire se trouve sur la partie centrale de la péninsule des Balkans, le territoire de la Bulgarie actuelle, bien que leur présence soit attestée jusqu’en Egypte et en Asie Mineure.
La période romaine
Elle marqua la péninsule des Balkans entre l’an 45, lorsque les Romains entrèrent victorieux en Thrace et le VI siècle où l’empire céda petit à petit sous les invasions de nouvelles tribus arrivées du nord. La conquête des terres thraces fut un processus qui d’étala sur plus de 200 ans. Après avoir d’abord soumis la Macédoine l’Empire romain élimina méthodiquement l’une après l’autre les unions tribales thraces, en les combattant directement, en concluant des alliances ou créant des tensions entre tribus afin qu’ils s’affaiblissent entre elles.
La Bulgarie
La Bulgarie existe en tant qu’état indépendant depuis l’an 681, année de l’instauration du Premier royaume bulgare. Byzance reconnut officiellement l’existence du nouvel état bulgare.
Les Ottomans
La Bulgarie se retrouve sous la domination des Ottomans entre l’an 1396, année de la chute du dernier royaume bulgare de Vidin et l’an 1878, année de la libération de Bulgarie par la coalition formée par la Russie, la Finlande et la Roumanie dans le cadre de la guerre engagée en 1877 par la Russie contre l’Empire Ottoman.
Au XIV siècle l’Empire Ottoman s’installa dans la péninsule des Balkans, déchirée par les guerres des différents royaumes et principautés féodales. A Constantinople leur invasion fut interprétée comme une « punition divine ». Néanmoins nombreux sont ceux qui préfèrent à l’époque voir le turban turc plutôt que la couronne du Pape. En effet, l’épisode latin, les saccages perpétrés par les Croisés et la dureté de l’Eglise catholique firent que la présence de ces non-chrétiens, tolérants vis-à-vis des libertés religieuses, fut bien plus acceptable. La présence d’un Empire Ottoman fort et en pleine expansion empêcha la conquête de ses terres par l’Occident catholique, qui alla se tourner plus tard vers les aventures maritimes et la découverte des Amériques.
La conquête ottomane provoqua de nombreux déplacements de populations. Ainsi, à la prise de Sofia 4 000 civiles furent transférés et établis à Constantinople (désormais Istanbul). A leur place furent implantées de populations nouvelles, déplacées de force de l’Asie Mineure.
L’empire soviétique
Le mouvement panslaviste avait commencé à se développer quelques années auparavant, mais il prend véritablement de l’ampleur avec l’insurrection bulgare d’avril 1876 réprimée dans le sang : 1 500 Bulgares sont en effet massacrés par les bachi-bouzouks turcs.
On s’émeut non seulement en Russie, mais aussi ailleurs en Europe. Victor Hugo en France proteste solennellement.
La guerre russo-turque de 1877-1878
C’est un conflit qui oppose l’Empire ottoman à l’Empire russe, allié à la Roumanie, à la Serbie et au Monténégro. C’est le premier conflit ayant comme toile de fond le panslavisme, assignant à la Russie le devoir de libérer les peuples slaves encore sous la domination turque et de constituer une confédération panslave.
Bloc de l’Est
Attribuée à la zone d’influence soviétique lors de la Quatrième conférence de Moscou confirmée par celle de Yalta, la Bulgarie entre de plain-pied dans le « bloc de l’Est » dès 1947
La chute du régime communiste
Les premières remises en question de l’économie socialiste en Bulgarie et de son alignement sur l’Union soviétique apparaissent en 1984 lorsque le « grand frère soviétique » se met à appliquer les tarifs internationaux à ses exportations de pétrole. Ce fait, conjugué à une forte sécheresse qui a pour résultat de faire baisser le niveau des cours d’eau alimentant les barrages hydroélectriques, suscitent un fort mécontentement populaire. L’arrivée au pouvoir à Moscou de Gorbatchev et sa volonté de ne plus soutenir les dirigeants communistes des pays de l’est obligent Jivkov à tenter, dans un premier temps, de s’adapter à la nouvelle ligne politique de Moscou en adoptant sa propre perestroïka, le Preustrojstvo. Dès janvier 1988, l’économie privée à petite échelle est autorisée en Bulgarie, mais sans la libéralisation politique du régime souhaitée depuis si longtemps par la population. A la chute du mur, la Buldarie se libère.
L’Europe
L’intégration de la Bulgarie au monde démocratique a été plus longue que pour d’autres pays du pacte de Varsovie. En décembre 2000, la levée de l’obligation de visa pour les Bulgares souhaitant voyager dans les pays de l’Union européenne représente un premier pas concret vers son intégration. La Bulgarie rejoint l’OTAN en 2004 et l’Union européenne en janvier 2007. Son intégration dans la zone euro, initialement prévue pour 2009, n’a toujours pas eu lieu.
La forteresse
Ancienne fortification romaine, puis ottomane, elle fut en service jusqu’au début du 20e siècle. Sa dernière reconstruction date du début du 19e siècle et a été réalisée par des ingénieurs français.
La forteresse occupe une partie élevée du terrain, à 610 mètres, s’assurant une vue imprenable à 180° au sud. Elle se déploie sur un total de 10 200 m², tirant profit des grands rochers pour appuyer et intégrer son ossature. Depuis ses postes d’observation le regard embrasse au sud la chaîne du Balkan, qui prend ici un grand virage vers le nord. L’on aperçoit le mon Kom, le point le plus élevé du Balkan occidental et la forêt de rochers rouges aux formes insolites se perd tout en bas, tel un paysage fantastique.
L’emplacement est parfait pour asseoir un point de contrôle stratégique entre deux cols de montagne. Ainsi dans la période entre le Ier et le IIIe siècle apparaît la première fortification-refuge, construite par les Romains. Elle avait pour mission la surveillance et la défense de cette zone et servait également de relais de communications. Les fouilles archéologiques ont permis de retrouver des fondations de murs, des fragments de céramique, des pointes en fer de flèches et de lances et des monnaies romaines de diverses périodes : Vespasien (70 à 79), Trajan 98 à 117), Septime Sévère (193 à 211), Gordien III (238 à 244), Trajan Dèce (249 à 251). De l’époque romaine demeurent des emplacements de grandes poutres, de marques de constructions légères et des sillons creusés dans la roche afin de récolter l’eau de puits vers une grande citerne de 85m². Les éléments archéologiques indiquent que la forteresse continua à servir pendant la Haute antiquité. Au temps du Second royaume bulgare, le roi Ivan Sratzimir (1356 à 1396) la fortifia et consolida. Deux murailles se sont ajoutées des côtés sud-est et nord-est ainsi qu’un nombre de structures auxiliaires. De nombreux escaliers taillées dans la roche et des ponts en bois suspendus facilitaient le déplacement rapide au sein de la forteresse.


Points positifs
Très belle forteresse et nous gardons un incroyable souvenir de l’opéra en plein air.
Points négatifs
La route pour se rendre à Bélogradtchik, n’est pas vraiment dans un très bon état. Soyez donc prudent. La ville est un peu loin de Sofia, donc si vous y allez pour voir un opéra, et admirer les paysages, c’est une bonne idée. Si ce n’est que pour voir la forteresse, allez plutôt vers Plovdiv et la mer noire.
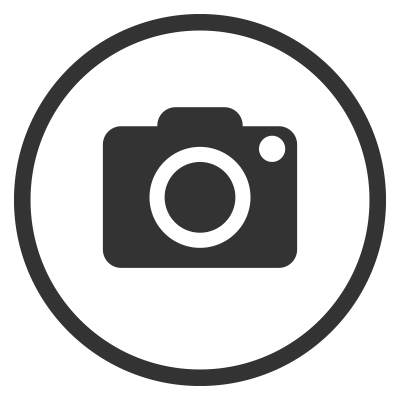
Astuce photo
Le site est très photogénique, son allure variant selon les couleurs de la saison et les levers et les couchers de soleil. Les photographes amateurs y trouveront un grand plaisir à capter un instant unique.
L’un des points de vue principaux est à l’entrée du site, à la porte de la forteresse, surtout en fin d’après-midi et au coucher du soleil (car donne à l’ouest).
Pour avoir un vaste aperçu sur le site géologique il faut monter les marches et se retrouver un haut. De là différents points s’offrent sur 180 degrés, permettant d’englober cette forêt imaginaire de rochers rouges.
On trouve un autre point, moins connu mais tout aussi valeureux, en empruntant l’allée derrière l’hôtel Skalité (les Rochers) qui se trouve sur la place centrale de Bélogradtchik. Après 150-200m vous sortez sur des points de vue fort appréciables.